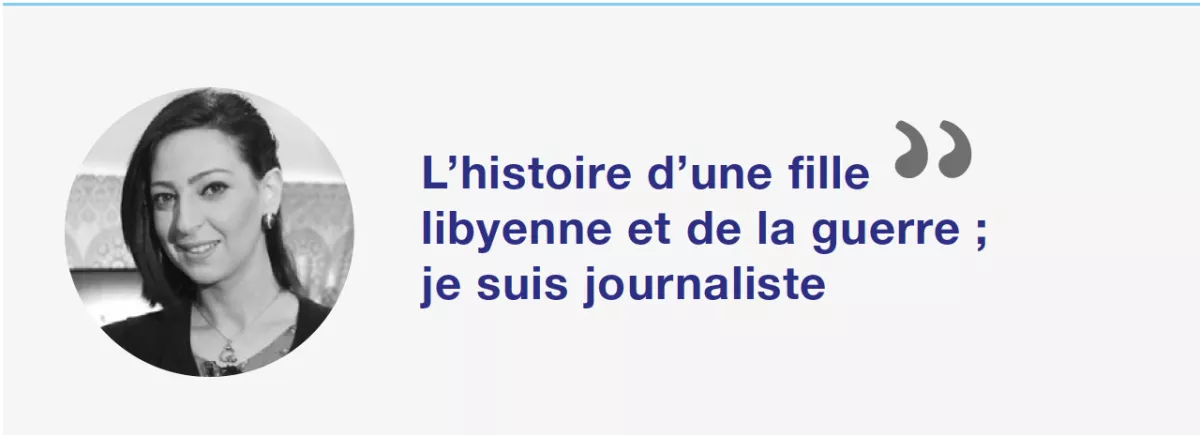
Moi, journaliste libyenne : Malak Beit Al Mal
Projet associé
HiwarLe témoignage de Malak Beit Al Mal, journaliste à la fondation Al-Ahram en Égypte.
Je m'appelle Malak Beit Al Mal.
Je n'avais pas l'intention de partir, j'y suis née et j'y ai grandi. J'y ai passé mon enfance et mes vingt ans. J'ai étudié à la faculté de droit ; je rêvais d'être avocate et de défendre les droits de tout citoyen libyen victime d'injustice, mais j'ignorais que mon rêve se limiterait à un poste lié aux affaires juridiques à la Centrale électrique.
Toutes les circonstances qui m'entouraient m'ont obligée à partir, ou plutôt à m'enfuir.
Oui, je l'avoue, je me suis enfuie de toutes ces chaînes qui m'entravaient dans mon pays. On quitte normalement les terres d'immigration pour retrouver sa patrie où règnent sécurité et stabilité, juste pour retrouver ses parents, amis et voisins. Mais moi, j'ai décidé de fuir mon pays pour me réfugier dans les ténèbres de l'exil et je parle de ténèbres car j'ignore où je vais, j'ignore mon avenir et celui de ma famille, de mon père, de ma mère, de mes sœurs. J'ignore surtout ce qu'il adviendra de nous après.
La Libye était le seul pays que je connaissais. Je n'étais auparavant jamais sortie au-delà de ses frontières et, plus précisément, au-delà de Tripoli, rue du quartier Hay Al Andalus. Mon père était un simple employé. Il n'avait pas les moyens d'offrir un voyage à ses quatre filles et à leur mère. Il s'inquiétait d'ailleurs tellement pour nous qu'il faisait attention à tous nos déplacements. Je me contentais donc des visites familiales et, parfois, d'une sortie à la plage dans la région de Tajoura, quand la situation financière de mon père le permettait.
Je me contentais de peu et, comme toute fille libyenne, j'espérais me marier (pour réaliser mes rêves comme voyager, quitter ma famille et avoir la vie que je désirais). J'allais avoir trente ans et je n'étais toujours pas mariée, à cause peut-être des conditions économiques difficiles de la vie ou parce que j'atteignais un âge pas très apprécié chez les Libyens pour se marier. En effet, une mère veut toujours que son fils épouse une fille qui soit au début de la vingtaine, ravissante. Quant à moi, je ne suis pas d'une grande beauté. Je ne me considère pas laide non plus, mais je pense que la chance n'a toujours pas sonné à ma porte.
La Révolution a eu lieu. J'en ai vécu toutes les étapes dans les rues de Tripoli, avec un sentiment mitigé : prisonnière des murs de ma maison, je ressentais la peur qui nous envahissait, ma famille et moi d'une part, et le bonheur à l'idée que tout allait changer pour le meilleur après la fin de Kadhafi. Oui, la Révolution a mis fin à Kadhafi. Là, l'histoire commence…
Je me souviens très bien du discours de la libération prononcé par le conseiller Moustafa Abdel Jalil. Je m'étais assise, avec mes quatre soeurs, ma mère et mon père, attendant le moment où le héros Abdel Jalil ferait son apparition pour nous présenter, ainsi qu'au monde entier, le discours historique qui mettrait fin à huit mois de souffrance. Je ne croyais pas ce que j'entendais : il permettait à l'homme libyen d'épouser quatre femmes, justifiant que c'était son droit dans l'Islam.
C'est alors que je me suis rendu compte que j'étais une fille en Libye et que ma vie ne serait plus désormais ni simple, ni facile.
Les évènements se sont alors succédés, comme si l'unique corruption qui existait dans le pays était la femme. Ils lui ont retiré son droit au quota dans la loi à l'Assemblée nationale et au Parlement, et même dans la formation des différents ministères en Libye. Ajoutons à cela la confusion causée par la loi interdisant aux femmes mariées à des étrangers de donner la nationalité libyenne à leurs enfants et l'annulation de la loi imposant aux hommes d'informer leurs femmes et d'obtenir leur accord avant d'épouser une autre femme.
La rue libyenne a alors rejeté la femme. Elle est devenue victime de harcèlement verbal et physique, surtout si elle n'était pas voilée ou n'avait pas le corps bien couvert. Cela pouvait parfois mener aux menaces si la fille ne se pliait pas à ces exigences.
Mais les menaces n'étaient pas tout. Cela pouvait aboutir au crime. Tout a commencé avec l'histoire des deux filles violées et tuées à Tripoli, puis d'autres histoires se sont succédé, jusqu'au crime le plus horrible de la Libye, qui a bouleversé le monde entier : le meurtre après effraction de la professeure et activiste Salwa Bugaighis, tuée cruellement par des hommes armés.
Je n'ai peut-être pas ressenti une grande peur à ce moment-là, parce que le crime a eu lieu loin, très loin de Tripoli. Mais la peur a commencé à grandir avec le grand nombre d'attentats perpétrés à Tripoli et les enfants et les filles enlevés de leurs maisons. Malgré tout cela, les raisons du voyage étaient autres.
Deux raisons sont à l'origine de notre départ : la première, c'est la tentative d'enlèvement dont a été victime ma petite sœur , alors qu'elle était en terminale. Trois jeunes hommes armés, à bord d'une voiture, ont essayé de l'enlever ainsi que son amie alors qu'elles rentraient de l'école.
Sans la présence de nos voisins, armés également, ma sœur ne serait plus de ce monde. Les affrontements ont abouti à la mort d'un membre de la bande. L'enlèvement s'est alors transformé en vengeance et je sais pertinemment que beaucoup de sang coulera avant que tout cela ne s'arrête.
La deuxième raison est une vidéo qui s'était répandue sur les réseaux sociaux, montrant une femme âgée qui se faisait violer chez elle, à Tripoli, avec ses propos touchants : "N'avez-vous pas de femmes ?!".
Ses agresseurs sont restés indifférents. Au contraire, cela n'a fait qu'aggraver leur brutalité. Je n'arrivais pas à croire que nous étions arrivés à ce stade en Libye : absence de respect pour les femmes, anesthésie des consciences, des valeurs qui étaient pourtant primordiales pour le peuple libyen. Tout s'est effondré.
Mes parents se sont enfin décidés : il fallait quitter le pays, s'éloigner de ce sexisme, de cette violence et de cette soumission dont souffrait clairement la femme. Nous ne reviendrons en Libye que lorsque ce pays deviendra un État ou redeviendra ce qu'il était pour que nous puissions y vivre. Je ne sais pas où nous irons ni comment nous vivrons, mais je suis sûre que notre situation sera meilleure, même temporairement, que celle que nous aurions en Libye, dominée par la peur et la menace. Point de sécurité loin du pays : c'est qu'on nous avait appris, tel était notre principe…
Mais les évènements qui ont lieu en Libye ont détruit tous nos repères de sécurité et de nation. J'espère seulement rentrer bientôt pour retrouver un pays qui protège mes droits et ma personne, puisqu'un Homme sans appartenance nationale est un Homme sans histoire.
Afin de préserver le dialogue démocratique en Libye, CFI a lancé, en partenariat avec le Centre de Crise et de Soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le projet Hiwar début 2017. Ce projet offre un espace d'expression de différents points de vue sur la presse libyenne. Une session, composée de quatre ateliers, a été organisée en Tunisie. Douze journalistes libyens, venant de Libye, de Jordanie, de Turquie, d'Égypte et de Tunisie, y ont participé.
Ce témoignage fait partie du livret Moi, journaliste libyen, qui regroupe des textes libres préparés par les journalistes du projet Hiwar.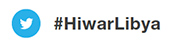
Retrouvez l'intégralité de ces textes dans le kiosque.



